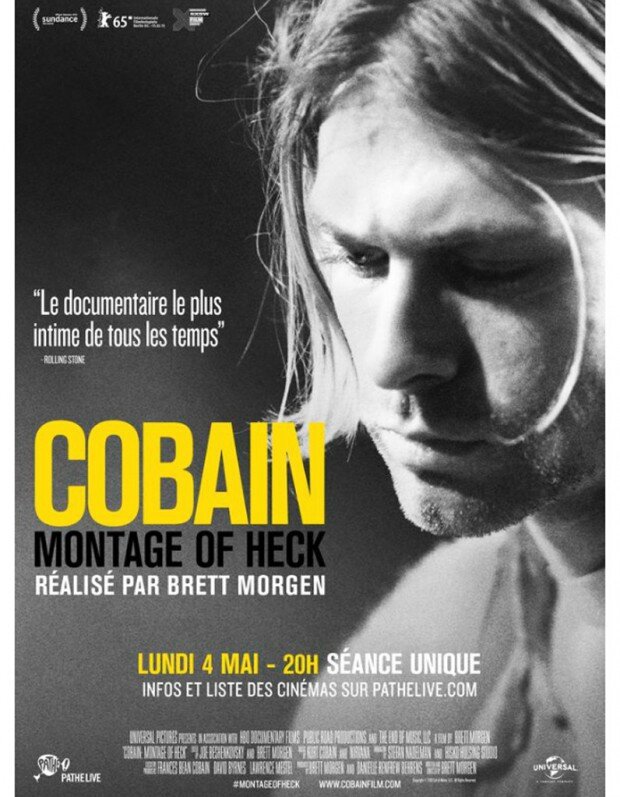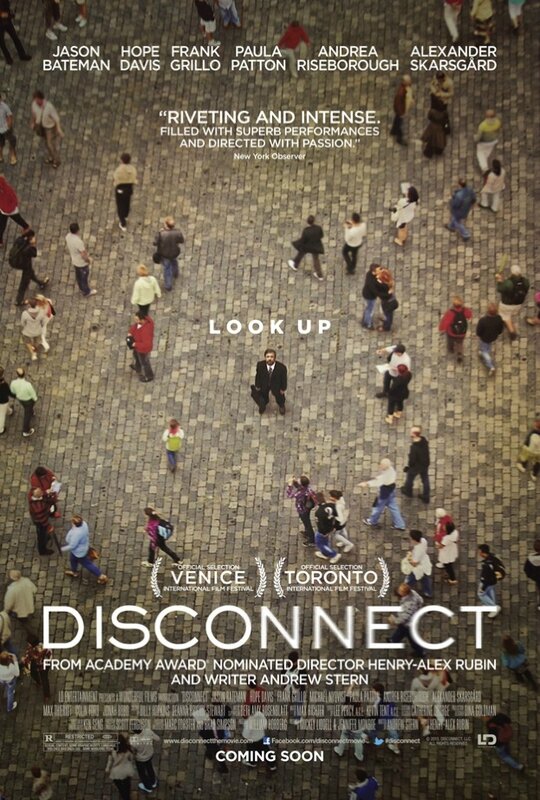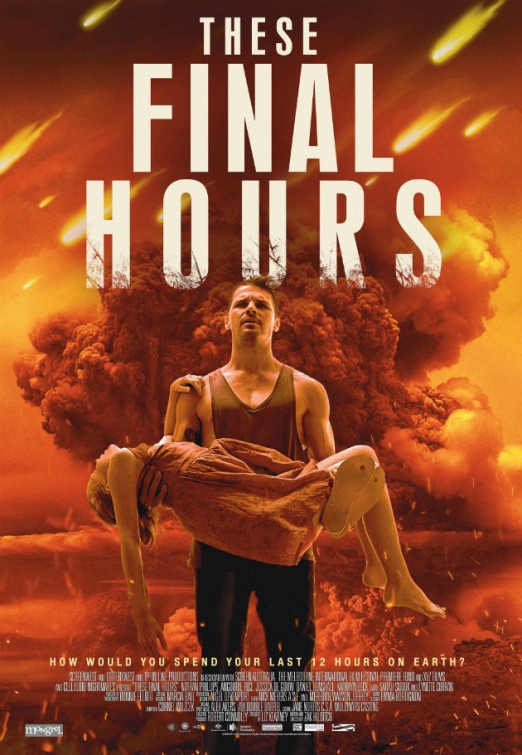DEATHGASM - EXTINCTION
Dans la série des "split entries" je vous propose aujourd'hui un grand écart entre deux films n'ayant rien à voir l'un avec l'autre, mais étant susceptibles de vous enthousiasmer chacun à leur façon.
Si les deux partagent un certain goût pour des formes horrifiques indéniables, leur approche se situe toutefois aux opposés, mais ils se complètent assez bien d'une certaine manière...
Mais commençons donc par le plus délirant des deux, qui vous fera hurler de rire, pour peu que certains codes vous soient familiers...
DEATHGASM
 Alors de deux choses l'une. Ou de trois d'ailleurs. Vous aimez le cinéma potache et ludique de Nouvelle Zélande. Vous vénérez les débuts de Peter Jackson, Housebound vous a fait pleurer de rire, et vous n'êtes pas contre un petit Black Sheep ou un Bad Trip bien troussés. En plus, le gore qui tâche et qui éclabousse ne vous dérange pas, pour peu qu'il n'atteigne pas votre T-Shirt de Mayhem flambant neuf. Et de trois, en lien avec le point précédent, vous êtes un accro à la musique extrême, Death, Black, Grind, et alors là, autant vous dire que vous allez vivre une véritable épiphanie cinématographique et musicale....
Alors de deux choses l'une. Ou de trois d'ailleurs. Vous aimez le cinéma potache et ludique de Nouvelle Zélande. Vous vénérez les débuts de Peter Jackson, Housebound vous a fait pleurer de rire, et vous n'êtes pas contre un petit Black Sheep ou un Bad Trip bien troussés. En plus, le gore qui tâche et qui éclabousse ne vous dérange pas, pour peu qu'il n'atteigne pas votre T-Shirt de Mayhem flambant neuf. Et de trois, en lien avec le point précédent, vous êtes un accro à la musique extrême, Death, Black, Grind, et alors là, autant vous dire que vous allez vivre une véritable épiphanie cinématographique et musicale....
Deathgasm, pour nous autres, Hard Rockeurs, c'est le film qu'on attendait depuis longtemps, qui va enfin enterrer dans le plus profond caveau du nanar l'horrible Hard Rock Zombies, et nous donner une légitimité comique que nous méritons bien. Si Wayne's World et Spinal Tap nous ont en quelque sorte permis d'accepter le second degré de notre musique préférée - et de l'assumer sans honte - Deathgasm en sera l'équivalent pour les aficionado du Black Métal, pas forcément réputés pour leur esprit guilleret et ouvert. Mais résumons.
Brodie est un pauvre orphelin fan de Métal sombre qui est recueilli par son oncle et sa tante après que sa mère ait complètement pété les plombs, dans tous les sens du terme. Ceux ci, des bigots blancs de pureté comme un sermon du dimanche, voient d'un très mauvais oeil ses accointances avec le milieu pseudo "satanique" du Métal extrême, et son cousin en profite même pour lui coller quelques raclées et autres humiliations d'usage.
Un jour, Brodie rencontre le ténébreux Zakk, chez un disquaire du coin. Lui aussi est fasciné par l'underground musical, et les deux acolytes ont tôt fait de monter un groupe improbable avec les deux plus ou moins potes nerd de Brodie, laissés pour compte et boucs émissaires comme lui.
Un soir, Zakk propose d'entrer par effraction dans une masure de banlieue, pour y dérober ce qu'ils y trouvent. C'est alors qu'ils tombent sur une ex star du Métal paranoïaque, hirsute et déjantée, auquel ils volent un vinyle ultra collector, sans savoir qu'il cache dans sa pochette une partition diabolique, qui une fois jouée, réveille un démon ancien qui de sa puissance néfaste change les pauvres hères ayant laissé traîner leurs oreilles trop près de la mélodie en monstres sangunaires. Et c'est évidemment ce qui va se passer, à notre plus grand bonheur.
Si Metalhead abordait déjà la passion d'une adolescente incomprise pour le Black Métal et la solitude qui l'accompagne souvent sous sa forme la plus dramatique, Deathgasm ne s'embarrasse pas d'une quelconque dramaturgie, et joue l'excès dans tous les domaines. Hymne Teen furieux à la musique extrême, aux amours impossibles et pourtant possibles, et surtout, gros délire foutoir qui permet des exactions gore et des séquences musicales désopilantes (les répètes du groupe sont fantastiques, du look aux approximations, notamment dans le premier solo de Brodie, quant aux fantasmes illustrés à la Wayne's World, les fans de True Metal vont adorer, sans parler des cochons qui aiment bien les nichons...), Deathgasm est un énorme plaisir même pas coupable, qui multiplie les clins d'oeil (styles musicaux, looks, expressions, tout y passe, de "C'était brutal" à "Métal Up Your Ass" en passant par le foutage de gueule en règle de POISON...), tout en suivant une ligne narratrice cohérente, mélangeant le Bad Taste de Jackson et la vague zombiesque des années 2000. Bien sur, tout le monde peut apprécier cette orgie baroque qui offre une cinématographie éblouissante, lardée de cuts, de plans séquences hallucinants, dynamisée par un montage nerveux, mais il est certain qu'en faisant partie de la "famille Métal", le ballet prend des allures de Mazurka endiablée.
Le fond ET la forme, du gros qui tâche mais aussi de la sensibilité pas trop appuyée, des clins d'oeil en veux tu en voilà, du rythme, des astuces visuelles incroyables, Deathgasm est une bombe et prouve par la même occasion que lorsqu'une blague est élaborée par un passionné, le résultat est toujours probant.
Comme quoi, on peut écouter Burzum ET aimer rire. Si, c'est possible.
Deathgasm - Official Trailer
player" width="480" height="270">
EXTINCTION
 Direction maintenant l'Espagne, pour changer radicalement de propos et de ton. On sait de source sure que le cinéma ibérique traverse une crise sans précédent, à tel point que certaines participations à des festivals semblent remises en cause, faute de fonds pour la production...Alors la qualité va déclinant bien sur, les producteurs ne prennent pas de risques, et l'auto financement devient la solution, bridant bien sur la créativité...Mais voici un contre exemple brillant, qui même s'il a nécessité une collaboration entre plusieurs pays, confirme le talent de scénariste et de metteur en scène de Miguel Angel Vivas déjà responsable du plutôt très bon Kidnappés.
Direction maintenant l'Espagne, pour changer radicalement de propos et de ton. On sait de source sure que le cinéma ibérique traverse une crise sans précédent, à tel point que certaines participations à des festivals semblent remises en cause, faute de fonds pour la production...Alors la qualité va déclinant bien sur, les producteurs ne prennent pas de risques, et l'auto financement devient la solution, bridant bien sur la créativité...Mais voici un contre exemple brillant, qui même s'il a nécessité une collaboration entre plusieurs pays, confirme le talent de scénariste et de metteur en scène de Miguel Angel Vivas déjà responsable du plutôt très bon Kidnappés.
On le sait, les Post Ap', depuis le début des années 80, c'est la mode. Cette mode connaît un revival depuis la fin des 90's, et certaines oeuvres sont même passé au panthéon, à l'instar du surfait World War Z, ou du brillant 28 Jours Plus Tard. Nous eûmes droit aux chefs d'oeuvre, mais aussi aux prod' fauchées, aux blagues françaises de mauvais goût (certes, jamais pire que Terminus, le mètre étalon du nanar), et parfois, à des approches dramatiques élusives et poignantes, même si encore un poil maladroites. Récemment, le finaud Hidden ajoutait sa pierre à l'édifice, et aujourd'hui, c'est Extinction qui attaque le clocher, avec son presque huis clos tendu, nerveux, et psychologique. Mais résumons.
Scène d'ouverture sans ambages, un car scolaire trimbale une tripotée de civils sous la surveillance/protection de militaires, pour un éloignement vers une zone de confinement. Le premier bus s'arrête, une détonation résonne, et le chaos déchire soudain le silence pesant pour une orgie de violence. A bord de ce car, Patrick et Emma, avec leur bébé, mais aussi Jack. Les quatre s'en tirent comme ils peuvent, non sans y laisser des plumes. Blackout. On les retrouve - plus ou moins - neuf ans plus tard, alors que la terre semble ravagée par un hiver nucléaire (assez incompréhensible d'ailleurs, nous n'en saurons pas plus), habitant un coin paumé (Harmony, Californie) chacun de leur côté. On comprend assez vite que quelque chose à mal tourné, puisque Jack et Patrick ne s'adressent plus la parole, qu'Emma a disparu, et que la petite Lu croit que son propre père est Jack.
La menace des mutants/zombies semble maintenant éradiquée, et chacun vit de son côté du palier, Patrick buvant plus que de raison et trifouillant une radio amateur pour chercher un peu de compagnie, tandis que Jack fait l'école à domicile à Lu, qui elle même donne quelques biscuits en douce au chien de Patrick. Ménage à trois isolé, la survie suit son cours, mais très vite, la menace surgit...Et si les monstres étaient vraiment revenus?
Propos de base, qui thématiquement n'offre rien de neuf, mais qui dans le traitement se la joue gentiment The Dead Outside, et privilégie l'humain sans pour autant négliger le fantastique. Mise en forme par une équipe d'acteurs au top du top (Matthew "Lost" Fox, Jeffrey "Blair Witch 2" Donovan, Clara "Inside" Lago et la petite et toute mignonne Quinn McColgan), l'histoire d'Extinction est brillante mais simple par son désir de décrire ce qui resterait d'humanité et d'égoïsme, et de rancoeur dans un monde perdu, promis à une fin très proche. Beauté des paysages (même si certains sentent un peu trop l'artificiel de studio), photographie remarquable de pureté dans les tonds froids et rayonnante dans les tons chauds, montage qui prend son temps et utilisation toute en sobriété des espaces négatifs. Absence de scare jump trop facile, dialogues bien écrits et parfois émouvants, ce long métrage fait preuve d'une belle humilité dans le brio, et suscite autant la peur que l'émotion, sans jamais tomber dans la facilité.
Le tour de force est d'avoir réussi à "forcer" indirectement le spectateur à s'intéresser tout autant au quotidien des trois protagonistes (les scènes de flashback explicatives sont un exemple de modération), qu'à la menace ambiante qui grouille dans la pénombre (utilisation intelligente de l'espace/son à travers des hauts parleurs extérieurs), et cette ambivalence découle sur une crédibilité prenante, même ci certains réflexes semblent parfois légèrement déplacés. On peut y voir une version intimiste mais pas ascétique du I Am Legend de Francis Lawrence, mais aussi un simple drame de la déchirure familiale en forme de métaphore apocalyptique. C'est en tout cas une très bonne raison de s'abandonner pendant presque deux heures, qu'on ne voit d'ailleurs pas passer, tant les acteurs se mettent au niveau d'un réalisateur inspiré et pudique. Quant à savoir si le cinéma espagnol y verra une catharsis, c'est un autre débat.
EXTINCTION Tráiler Oficial